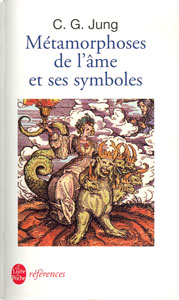
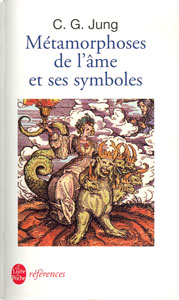
Note:
Psychologue et psychiatre suisse, Carl Gustav Jung ( 1875-1961 ), après avoir été l'un des premiers disciples de Freud, s'est écarté du modèle orthodoxe de la psychanalyse pour définir une approche personnelle de la psychologie des profondeurs sous forme d'une "psychologie analytique". L'empirisme spontané de Jung s'accordait mal avec le souci constant de Freud de parvenir à une théorie d'ensemble qualifiée par lui de topique, voire de métapsychologie. Par ailleurs, la tendance nettement matérialiste de la pensée freudienne heurtait chez Jung un intéret profond pour la problématique spirituelle.
Malgré sa divergence avec Freud concernant l'importance de la sexualité, la pensée de Jung reste dans une certaine mesure en résonance avec la démarche freudienne par l'idée cardinale que la psychologie individuelle n'est pas réellement dissociable de la psychologie collective. En ce sens, l'investigation de l'inconscient se prolonge naturellement pour tous deux dans l'étude des autres formes de la pensée symbolique: mentalité primitive, rites, folklore, mythologie, art, religion, dans une réflexion aussi sur les finalités de la culture et de la civilisation.
A propos de Jung, Gaston Bachelard devait écrire: " Nul depuis Socrate n'a exploré la psyché aussi profondément et avec autant de perspicacité."
( Préface du Traducteur: Y. Le Lay. pages 13 à 15 ).
Rappelons d'abord que la conception jungienne de l'inconscient diffère sensiblement de celle de Freud. Chez ce dernier en effet l'inconscient semble être surtout une puissance malfaisante en nous, née du refoulement de tendances insatisfaites qui continuent à mener malgrè nous une activité perturbatrice; ses manifestations sont surtout morbides et troublent le plus souvent plus ou moins profondément le cours normal de la vie. Chez Jung il en est tout autrement. Sans méconnaître ce qu'il peut y avoir en lui de morbide, il considère l'inconscient comme présent chez tout être humain; s'il peut être malfaisant, il peut aussi être bienfaisant. Toute vie psychique se compose nécessairement d'un conscient et d'un inconscient se compensant l'un l'autre. Cet ensemble constitue la totalité psychique dont nul élément ne peut disparaître sans domage pour l'individu: la perte de la conscience est aliénation, la perte de l'inconscient est appauvrissement et désordre.
Chacun de nous possède un inconscient individuel. Mais là ne s'arrête pas la richesse de notre psyché. Au-dessous de cet inconscient individuel-nous nous escusons de cette image topographique commode mais évidemment inexacte, l'inconscient étant, pourrait-on dire, partout et nulle part- au-dessous donc de cet inconscient individuel se trouvent des couches plus profondes et plus difficilement accessibles: ce sont les couches de l'inconscient archaïque. La psyché dépasse alors le psychisme individuel. Car cet inconscient a ceci de particulier qu'il n'est pas la propriété du seul individu; il ne se présente pas avec les traits spéciaux qui caractérisent une personnalité définie. Ses traits sont ceux de l'espèce et se retrouvent, sinon identiques, du moins étonnamment analogues, chez tous les représentants de la race humaine. ::
Dès qu'un analyse individuelle a été suffisamment poussée, qu'ont été en quelque sorte déblayés les éléments de l'inconscient personnel, on se heurte à ces traits caractéristiques qui se rencontrent chez tous les hommes. On a appelé archaïque cet inconscient à cause du caractère primitif de ses manifestations; on l'a appelé aussi collectif, pour bien marquer qu'il n'est pas la propriété d'un individu, mais celle d'une collectivité, en ce sens qu'il conserve, chez chaque représentant de l'espèce, les caractères généraux et impersonnels de cette même espèce. Tel le corps humain qui, en plus de la diversité caractéristique de chaque individu, porte en lui cependant les traits généraux de tout homme; telle la psyché, en dépit de tout ce qui peut l'individualiser, c'est à dire faire de chacune quelque chose d'unique et de jamais vu, conserve nécessairement des traits d'appartenance à l'espèce, par lesquels elle rapproche jusqu'à les confondre les représentants de cette même espèce.
La portée psychologique de cette conception est immense. Elle rapproche les uns des autres des hommes qui paraissent très différents; elle lie le présent au passé et à l'avenir. A regarder les hommes d'aujourd'hui, nous avons l'impression d'une étonnante et insurmontable diversité, comme si grandissait à travers les âges, avec une rapidité continuellement accrue, l'individualisation qui particularise chacun. Cela se traduit par une recherche de l'originalité, poussée parfois jusqu'à l'absurde, et paraît creuser entre les hommes un abîme insurmontable de différentiation. En fait, cette différenciation n'est qu'apparente. Quoi qu'il fassent, les hommes restent ce qu'ils sont; ils se ressemblent et leurs traits personnels reflètent les grandes lignes collectives. La différentiation tient uniquement aux moyens d'expression. Les réactions aux éternels problèmes humains, une fois dépouillées des nuances personnelles par lesquelles elles s'expriment, se révèlent étonnamment semblables. Le langage diffère; l'objet reste le même. La même idée, le même objet se peuvent traduire par les termes particuliers des différentes langues.
Cette
ressemblance fondamentale apparaît dès que l'on aborde l'inconscient
archaïque collectif; les différences disparaissent pour faire
place à une surprenante conformité qui ne concerne pas seulement
les hommes d'aujourd'hui; car la collectivité humaine n'est pas
seulement les hommes d'aujourd'hui; car la collectivité humaine
n'est pas seulement constitué par l'ensemble des hommes qui existent à un
moment donné et dont les particuliarités permettent de distinguer
des époques, des civilisations et des cultures. La collectivité humaine,
c'est l'ensemble des hommes du présent, du passé et de l'avenir.
Des liens obscurs courent à travers l'humanité depuis les âges
les plus reculés jusqu'aux futurs les plus lointains. Nos ancêtres, à peine
connus par les fouilles qui signalent leur existence, et nos descendants
les plus inimaginables, quels que soient leurs moyens d'expression: légendes,
mythes ou religions, théories philosophiques ou conceptions scientifiques
du monde, tous manifestent ou manifesteront dans leur histoire fabuleuses
ou leur travaux scientifiques les mêmes tendances, les mêmes
désirs, les mêmes émotions. |
Là est la grande unité de l'esprit humain. Comme conséquence de cette unité apparaît l'appartenance de chacun aux grandes lois de l'espèce. L'homme d'aujourd'hui a une tendance à se croire supérieur à celui d'autrefois, en même temps qu'il éprouve une sorte d'envie quand il imagine ce que pourront être ceux qui viendront après lui. Mais ce faisant il se leurre: sa pensée répète et continue celle de jadis, sans jamais oublier les problèmes qui sont son éternelle préoccupation. Si la raison a pris parfois une place prépondérente, il faut bien se pénétrer de l'idée que la raison n'est qu'une méthode de réflexion sur les choses et non une transformation de la nature; elle découvre l'enchainement des phénomènes: elle ne le fait pas. (...)
 |